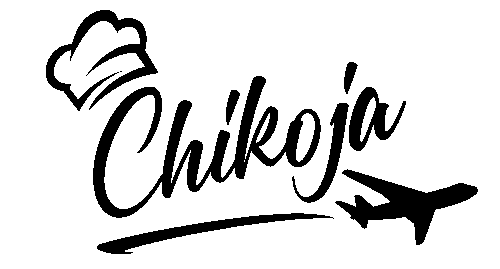En bref :
- La fermeture exceptionnelle permet à l’employeur d’interrompre l’activité, sous réserve d’un strict encadrement légal.
- Elle se distingue des congés payés planifiés, des jours fériés et du dispositif d’activité partielle.
- Plusieurs motifs peuvent la justifier : raisons économiques, travaux, catastrophes, pandémie…
- La consultation du CSE doit avoir lieu au moins deux mois à l’avance, sauf absence de CSE.
- L’information des salariés est obligatoire ; le défaut d’anticipation expose l’employeur à des contentieux.
- Des alternatives existent pour les salariés sans congés disponibles : télétravail, congé sans solde, solutions financières.
- La communication envers la clientèle doit être organisée pour préserver l’image de l’entreprise.
Comparateur des Régimes : Fermeture exceptionnelle, Congés payés, Activité partielle
| Aspect | Fermeture exceptionnelle | Congés payés | Activité partielle |
|---|
Lexique rapide & sources juridiques
- Fermeture exceptionnelle : fermeture momentanée de l’entreprise pour raison imprévue (intempérie, crise sanitaire…).
- Congés payés : période de repos réglementaire rémunérée accordée sur demande ou par décision de l’employeur.
- Activité partielle : réduction temporaire d’activité ouvrant droit à une indemnisation encadrée par l’État.
- Source : Service-public.fr – Période de chômage partiel ou technique
En 2025, la capacité d’une entreprise à faire face aux imprévus ou à s’adapter à des circonstances exceptionnelles est devenue un marqueur majeur de résilience face à un environnement économique, sanitaire et social toujours plus incertain. La fermeture exceptionnelle, mesure souvent controversée mais encadrée par le Code du travail, suscite de nombreuses interrogations chez les employeurs comme les salariés. Entre exigences légales rigoureuses, devoir d’information, et gestion des droits sociaux, ce dispositif relève autant de la stratégie RH que du pilotage opérationnel. Face à des situations aussi variées qu’une panne technique généralisée, une crise pandémique ou une période creuse saisonnière, la fermeture imposée ne s’improvise pas : elle implique des arbitrages parfois sensibles pour garantir à la fois la rémunération des salariés et la pérennité de l’activité. Pour l’entreprise fictive « ArtisPro », spécialisée dans l’édition de mobilier urbain, la nécessité successive de fermer pendant la canicule estivale, puis lors de travaux d’envergure, a révélé tout l’enjeu d’une planification conforme aux obligations légales et attentive à la communication interne comme externe. Entre recherche de solutions pour les équipes sans reliquat de congés, négociation avec le CSE, et maintien de la relation client, l’expérience d’ArtisPro éclaire, à travers son parcours, les enjeux actuels de la fermeture exceptionnelle en entreprise.

Fermeture exceptionnelle imposée par l’employeur : définition et contextes d’application
La fermeture exceptionnelle se définit comme une suspension temporaire imposée par l’employeur de l’ensemble, ou d’une partie, de l’activité de l’entreprise, en dehors du cadre ordinaire des congés annuels ou des jours fériés. Le recours à cette mesure peut résulter de diverses situations : travaux imprévus de maintenance, désorganisation due à une épidémie, catastrophes naturelles, baisse prévisible et répétée d’activité lors des périodes creuses, ou même survenance d’un sinistre grave (source).
Dans les faits, une multitude d’événements peuvent conduire à ordonner la fermeture exceptionnelle d’ArtisPro, que ce soit un problème technique remettant en cause la sécurité au travail ou la nécessité de s’aligner sur une période de vacances majoritaire dans le secteur. Il s’agira toujours d’un acte de gestion qui doit se différencier du recours aux congés annuels programmés et qui s’inscrit dans un cadre très précis. Chaque décision doit prendre en compte la réalité de l’entreprise : ainsi, un commerce du littoral adapte fréquemment l’usage de la fermeture à la saisonnalité, tandis qu’une usine devra y recourir suite à un sinistre technique rendant impossible la production.
Différences entre fermeture exceptionnelle, congés payés, jours fériés et activité partielle
Une distinction claire s’impose entre la fermeture exceptionnelle et d’autres formes d’interruption d’activité telles que les congés payés individuels, les jours fériés, ou encore l’activité partielle. La fermeture exceptionnelle s’applique de façon collective, imposée par l’employeur, souvent pour raison technique ou organisationnelle.
- Congés payés : planifiés et choisis conjointement avec le salarié, ils suivent une procédure stricte de pose et validation. Leur cadre est déterminé par la gestion annuelle des CP et, le plus souvent, un calendrier prévisionnel (voir détails ici).
- Jours fériés : régis par le Code du travail, leur octroi ne dépend ni de l’employeur ni du salarié, mais du calendrier légal et de la convention collective.
- Activité partielle : dispositif d’urgence, souvent actionné lors de crises majeures (économiques, sanitaires), il permet de suspendre ou réduire l’activité tout en offrant une indemnité partielle financée par l’État (voir l’analyse).
| Dispositif | Initiateur | Motif principal | Indemnité / Rémunération | Procédure |
|---|---|---|---|---|
| Fermeture exceptionnelle | Employeur | Imprévu/saisonnier/technique | Salarié payé (ou selon alternatives) | Consultation CSE, info salariés |
| Congés payés | Salarié / Employeur | Repos, prévisionnelle | Maintien de salaire | Calendrier annuel/Requête |
| Jour férié | Loi | Réglementaire | Maintien de salaire | Automatique |
| Activité partielle | Employeur (avec validation) | Conjoncture difficile | Indemnité chômage partiel | CSE, demande DREETS |
Distinction juridique entre fermeture exceptionnelle et congés annuels
Sur le plan juridique, la fermeture exceptionnelle obéit à des règles particulières. Elle ne peut être confondue avec la fermeture annuelle pour congés, bien que les deux puissent parfois coïncider, notamment en été. La fermeture exceptionnelle, imposée sans anticipation, doit s’accompagner de garanties pour les salariés, notamment sur la rémunération (plus d’infos ici). Ainsi, la distinction se fait sur :
- La nature de l’événement : imprévu vs planifié
- Le régime d’information et délai
- L’impact sur les reliquats de congés
- Les possibilités de recours à d’autres solutions (télétravail, RTT, adaptations sur mesure)
Cas d’exclusion : jours fériés et recours à l’activité partielle
Les jours fériés fixés par le Code du travail ne constituent pas en eux-mêmes une fermeture exceptionnelle, sauf lorsqu’ils donnent lieu à une fermeture générale non prévue au calendrier. Des conditions spécifiques entourent le recours à l’activité partielle (notamment demande auprès de la DREETS et validation), qui permet notamment aux entreprises de maintenir allégée leur structure financière lors de crises majeures – comme observé lors des confinements (lire détails).
Motifs légitimes de fermeture exceptionnelle en entreprise
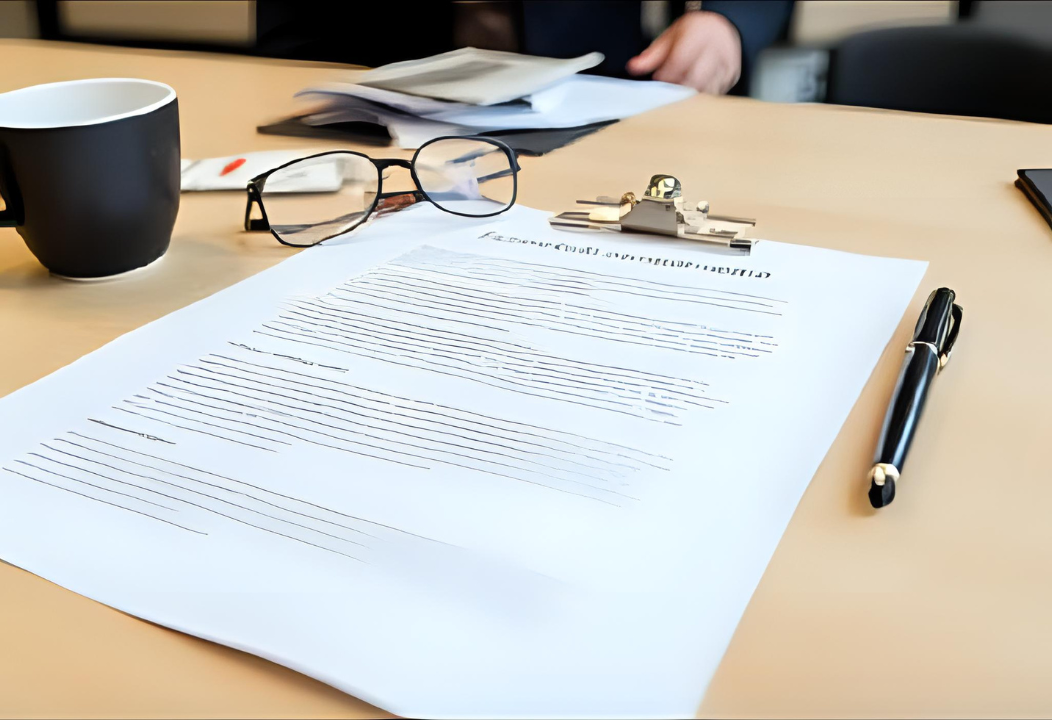
La fermeture exceptionnelle n’est admise que sous réserve de circonstances avérées et objectivement justifiables. À travers l’expérience d’ArtisPro, l’employeur a successivement invoqué des motifs économiques en période de faible activité estivale, puis la nécessité absolue de procéder à des travaux imprévus suite à une panne majeure. Bien que la latitude de l’employeur soit grande, chaque décision nécessite une justification formelle pour éviter une requalification ou une contestation.
- Voici quelques exemples fréquemment admis :
- Périodes creuses d’activité (constatées sur plusieurs années)
- Maintenance des infrastructures vitales
- Obligation légale ou réglementaire liée à la sécurité
- Evénement imprévu : incendie, inondation, cyberattaque
- Pandémie, crise sanitaire majeure (ex : COVID-19, 2020-22)
Raisons saisonnières, économiques et techniques : cadre juridique
La jurisprudence admet que certains secteurs (restauration balnéaire, construction, industrie lourde) recourent à la fermeture exceptionnelle lors de baisses d’activité structurelles. Le caractère exceptionnel doit néanmoins être authentifié par des éléments factuels : baisse continue du chiffre d’affaires sur plusieurs cycles saisonniers, travaux imposés par des contraintes administratives, difficultés techniques graves rendant impossible la poursuite du service public ou privé.
| Motif | Preuve exigée | Solutions alternatives |
|---|---|---|
| Saisonnalité | Historique d’activité et calendrier conventionnel | Recours à des emplois saisonniers, modulation |
| Travaux | Devis, avis de sécurité, rapport technique | Maintenance par secteur, rotation des équipes |
| Baisse économique | Bilan financier, prévision d’activité | Réorganisation temporaire, relance commerciale |
| Catastrophe ou crise sanitaire | Rapports officiels, arrêté préfectoral | Activité partielle, télétravail |
Gestion des événements imprévus : catastrophe, sinistre, pandémie
En cas de sinistre ou catastrophe, la fermeture exceptionnelle devient la seule solution envisageable pour garantir la sécurité des personnes. La gestion de crise suppose alors une organisation immédiate pour informer le personnel et envisager les soutiens possibles (aides France Travail, recours à une cellule psychologique, etc.). La pandémie de COVID-19 a ainsi illustré, dans l’ensemble du tissu économique français, l’importance d’une anticipation juridique de ce type de situation. La rapidité d’exécution, la clarté de la communication et le respect des étapes réglementaires demeurent incontournables.
Règles légales encadrant la fermeture exceptionnelle : procédures obligatoires
L’encadrement légal de la fermeture exceptionnelle repose sur une articulation exigeante entre pouvoirs de direction de l’employeur, droits des salariés et impératifs de dialogue social. La prise de décision ne peut résulter d’un simple acte unilatéral, particulièrement en présence d’un CSE. La conformité avec les conventions collectives et les accords d’entreprise prévaut. Voici les principales règles que doit observer tout employeur confronté à ce choix :
- Consultation et information du CSE dans les délais légaux
- Respect d’une procédure écrite d’information des salariés
- Vérification de la régularité (pas d’abus, motif réel et sérieux)
- Gestion équitable des situations individuelles particulières
Pouvoir de direction de l’employeur et respect des accords collectifs
Le pouvoir de direction donne à l’employeur la possibilité de décider d’une fermeture exceptionnelle, mais cette prérogative est encadrée dans ses modalités. Les accords collectifs ou la convention applicable à la société peuvent prévoir des obligations spécifiques : nombre minimal ou maximal de jours, compensation éventuelle, modalités de récupération ou d’affectation des congés.
À travers l’exemple d’ArtisPro, la direction a dû s’entretenir avec les élus du personnel pour valider le calendrier de la fermeture, s’assurer du respect des dispositions négociées, et anticiper les besoins en remplacement sur certaines activités non interruptibles. Il convient donc pour chaque entreprise de vérifier la hiérarchie de normes avant de se prononcer, sous peine de litige ou de sanctions ultérieures.
Consultation du comité social et économique : délais et formalités
La consultation du CSE constitue l’un des moments clés de la procédure. Cet organe représentatif doit obligatoirement être saisi au moins deux mois avant la date d’effet envisagée de la fermeture. Le CSE rend alors un avis, qui n’est pas prescriptif, mais l’employeur a l’obligation de justifier sa décision ultérieure si celle-ci va à l’encontre des observations (à lire sur culture-rh.com).
- En l’absence de CSE, la procédure d’information est allégée mais doit néanmoins respecter un délai raisonnable de prévenance.
- La transparence et la documentation des échanges sont vivement conseillées.
Des modèles d’ordre du jour, de compte-rendu de réunion et d’attestation d’information sont recommandés pour sécuriser juridiquement la démarche.
Obligations de dialogue social et principes de prévenance
Même si la loi ne contraint pas l’employeur à suivre l’avis du CSE, le respect des règles du dialogue social est non seulement gage de paix sociale, mais surtout un moyen de prévenir tout risque de requalification devant les juridictions (en savoir plus). La bonne foi et la clarté des échanges sont déterminantes pour la réussite d’une fermeture exceptionnelle.
Conditions de durée de la fermeture exceptionnelle et gestion des congés
La fermeture ne peut, en aucun cas, dépasser 24 jours ouvrables consécutifs, suivant le régime des congés annuels. Par ailleurs, au moins 12 jours consécutifs doivent pouvoir être pris, ce qui garantit aux salariés une période ininterrompue de repos conforme aux exigences du droit du travail.
| Règle | Durée maximale | Remarques |
|---|---|---|
| Fermeture totale pour cause exceptionnelle | 24 jours ouvrables | Inclut week-ends/feriés selon secteur |
| Congé ininterrompu obligatoire | 12 jours ouvrables | Consécutifs, en une fois |
Respect de la limite légale des 24 jours et minimum de 12 jours continus
Ce régime protège salariés comme employeurs d’éventuelles dérives, en évitant toute absence trop longue ou fractionnée. La limitation à 24 jours oblige à anticiper la succession des dispositifs (fermeture, reprise progressive, etc.) et à adapter le fonctionnement administratif pour assurer la cohérence de la paie et des droits sociaux.
Modalités d’information des salariés : contenu et supports recommandés
Les salariés doivent être avertis par écrit au moins un mois avant toute fermeture exceptionnelle. Un mail avec accusé de réception, un courrier recommandé, ou encore un affichage visible dans les locaux constituent les solutions les plus robustes. Ce message doit impérativement préciser :
- Les dates précises de la fermeture
- Le motif (technique, économique, sanitaire, etc.)
- Les conséquences sur la prise des congés et l’affectation des reliquats
- Les coordonnées du responsable à contacter en cas de question
Cette étape a été cruciale chez ArtisPro pour permettre à chaque membre de l’équipe d’anticiper ses projets personnels et d’assurer une continuité de la relation client.
Conséquences de la fermeture exceptionnelle pour les salariés et communication externe

La fermeture exceptionnelle a des effets variés sur les droits des salariés. Si la question du maintien de la rémunération demeure centrale, d’autres points, comme la gestion des congés ou l’accès à des dispositifs alternatifs (activité partielle, télétravail, aides de France Travail…), doivent être anticipés.
Gestion des droits des salariés : rémunération, congés et solutions en cas d’insuffisance
Dans la majorité des cas, une fermeture exceptionnelle impose aux salariés de solder ou consommer leur reliquat de congés payés. L’employeur peut légalement imposer les dates de congés – sous réserve de respecter la procédure exposée précédemment. Voici les principales options pour les salariés ayant peu ou pas de droits à congé restants lors de la fermeture exceptionnelle :
- Télétravail temporaire pour les postes compatibles
- Prise de congé sans solde (accord écrit indispensable)
- Déplacement sur d’autres sites/équipes en cas de multi-établissements
- Demande d’aide spécifique auprès de France Travail ou via la caisse de congés propres à certains secteurs
L’affirmation du droit au maintien de la rémunération est assortie d’exceptions : en cas de congés sans solde, le salaire n’est alors pas dû. Pour ArtisPro, plusieurs salariés ont choisi cette option, tandis qu’un responsable de maintenance a travaillé en télétravail sur des tâches de planification.
Imposition des congés payés et sanctions en cas de refus
Si un salarié refuse sans raison valable le principe ou les dates de congés imposés, l’employeur dispose d’un pouvoir disciplinaire permettant d’aller jusqu’à la sanction voire, dans les cas extrêmes, la faute grave. Cette prérogative est toutefois contrebalancée par l’obligation d’étudier les situations individuelles (maladie, préavis…). Pour éviter tout contentieux, il est conseillé de formaliser par écrit les différentes étapes, ce qu’a mis en œuvre ArtisPro pour justifier chaque mesure prise.
Solutions pour les salariés sans reliquat de congés : télétravail, congé sans solde, aides
En cas d’insuffisance de droits à congés, l’entreprise doit proposer d’autres solutions : l’affectation de RTT ou de jours de récupération, lorsqu’un accord le permet, ou la mise en place ponctuelle d’un télétravail. ArtisPro, dans plusieurs fermetures passées, a sollicité France Travail pour orienter ses salariés vers des missions temporaires, solution fréquemment employée par le secteur industriel (plus d’exemples).
Ce dispositif aide à préserver l’emploi et favorise l’accompagnement social, tout en consolidant la réputation de responsabilité de l’employeur.
Fermeture exceptionnelle et activité partielle : procédures et indemnisation
Face à une fermeture exceptionnelle dont la durée ou le contexte risquent de désorganiser l’équilibre financier de l’entreprise, l’activité partielle devient une alternative de secours. L’objectif : éviter des pertes de rémunération pour les salariés et préserver la compétitivité, notamment via une indemnité spécifique partiellement prise en charge par l’État.
- Tableau récapitulatif des étapes clés :
| Étape | Description | Acteur |
|---|---|---|
| Consultation du CSE | Présentation du projet d’activité partielle, échange sur les modalités | Employeur, CSE |
| Demande à la DREETS | Envoi du dossier décrivant le motif exceptionnel, estimation de la durée, justificatifs | Employeur |
| Notification aux salariés | Information écrite sur la mise en place, modalités d’indemnisation | Employeur |
| Indemnité versée | Versement d’une indemnité équivalente à 60% du salaire brut (sous conditions) Possibilité de compléments dans certains cas | Entreprise/État |
Motifs et mise en œuvre du recours à l’activité partielle
Les sociétés comme ArtisPro ont recours à l’activité partielle quand la crise dépasse les capacités de simple organisation interne. Celles-ci peuvent concerner, par exemple, une baisse spectaculaire de commandes ou des travaux rendant les locaux indisponibles pour une durée supérieure à la période de fermeture habituelle. Ce recours se différencie nettement d’une fermeture exceptionnelle simple et doit justifier l’origine du blocage d’activité (cf. éclairages de Likeo).
Consultation du CSE, démarches auprès de la DREETS et indemnité des salariés
Avant toute mise en œuvre de l’activité partielle, une consultation du CSE (quand il existe) s’impose, suivie d’une demande formalisée auprès de la DREETS. Le délai moyen pour retour est de 15 jours, et la documentation exigée est très détaillée (exposés, justifications comptables, impacts RH). Une fois la mesure acceptée, les salariés perçoivent une indemnité de chômage partiel, généralement fixée à 60% de leur salaire brut horaire, avec possibilité de complément par l’employeur.
Informer le public et les clients lors d’une fermeture exceptionnelle : canaux et bonnes pratiques
La communication externe occupe un rôle stratégique en période de fermeture exceptionnelle. Outre la stricte obligation d’information envers le personnel, soigner la démarche auprès du public, des clients et des partenaires permet d’anticiper d’éventuelles incompréhensions ou démobilisation du portefeuille d’affaires.
- Canaux recommandés :
- Mail groupé ou courrier adressé aux principaux clients
- Mise à jour visible sur le site internet (bannière, pop-up, FAQ dédiées)
- Publication sur les réseaux sociaux (ex : annonce sur LinkedIn ou X/Twitter)
- Affichage physique, signalétique claire devant l’établissement
- Message vocal d’accueil adapté pour les appels entrants
Sur l’exemple d’ArtisPro, la complémentarité entre ces différents leviers et la personnalisation des messages ont permis d’éviter tout malentendu et de valoriser la capacité d’anticipation de l’entreprise.
La fermeture exceptionnelle peut-elle être imposée sans préavis ?
Non, le préavis d’au moins un mois pour l’information des salariés est indispensable, tout comme l’anticipation du délai de consultation du CSE, sauf en cas d’urgence absolue avérée (ex : sinistre grave).
Un salarié peut-il refuser une fermeture exceptionnelle imposée par l’employeur ?
Le refus injustifié de prendre des congés imposés dans ce cadre peut entraîner des sanctions disciplinaires, sauf situation particulière (ex : congé parental, maladie, intervention validée par accord individuel préalable).
Quelles solutions pour un salarié sans reliquat de congés lors d’une fermeture exceptionnelle ?
Le salarié peut, avec l’accord de l’employeur, solliciter un congé sans solde, effectuer du télétravail si son poste le permet, ou être accompagné par France Travail pour une solution temporaire d’emploi ou d’aide.
Quels risques l’employeur encourt en cas de procédure irrégulière de fermeture exceptionnelle ?
En cas de non-respect des procédures informatives ou consultatives, l’inspection du travail peut sanctionner l’employeur, et les salariés peuvent obtenir une régularisation de leur rémunération par le conseil de prud’hommes.